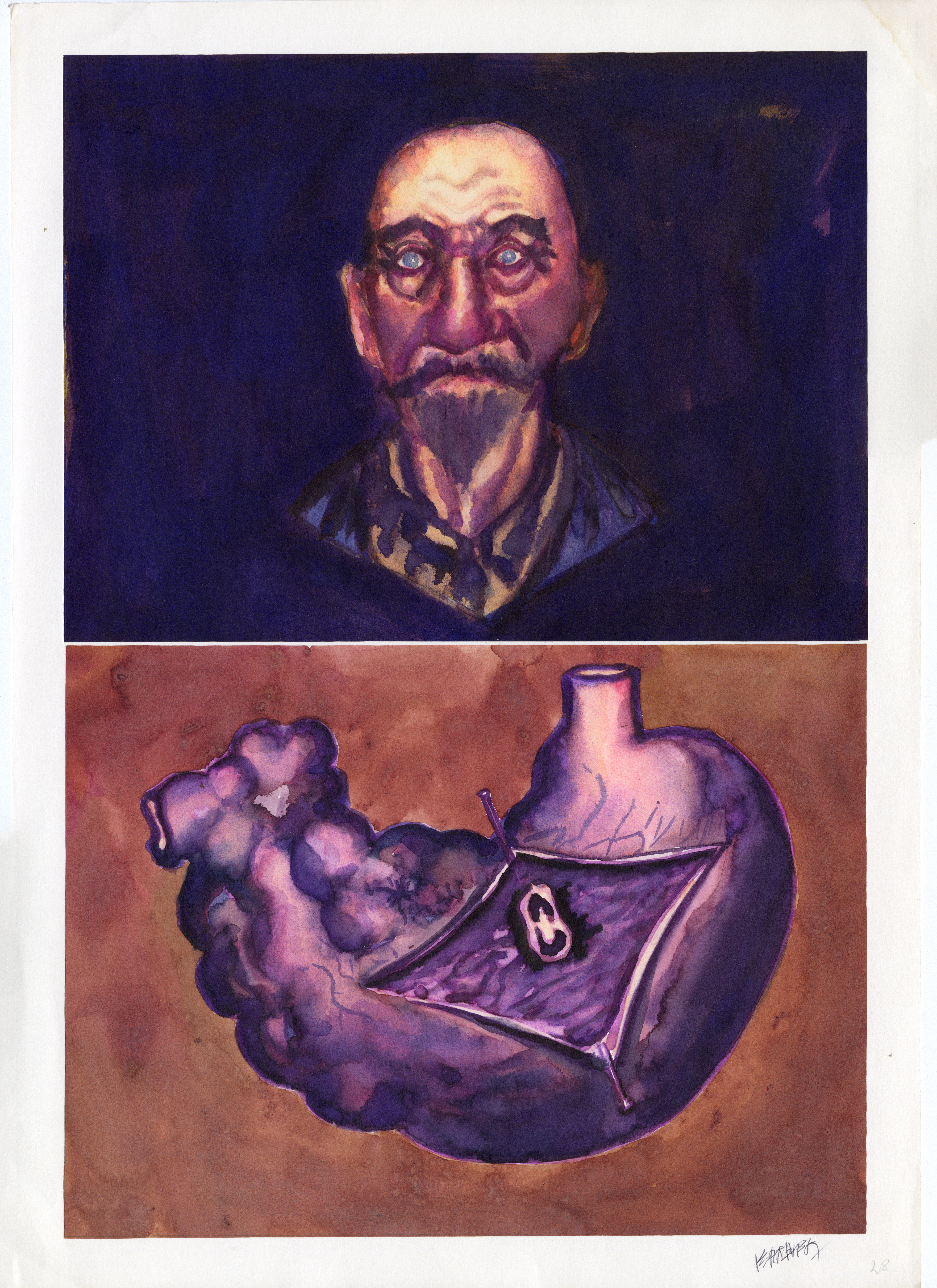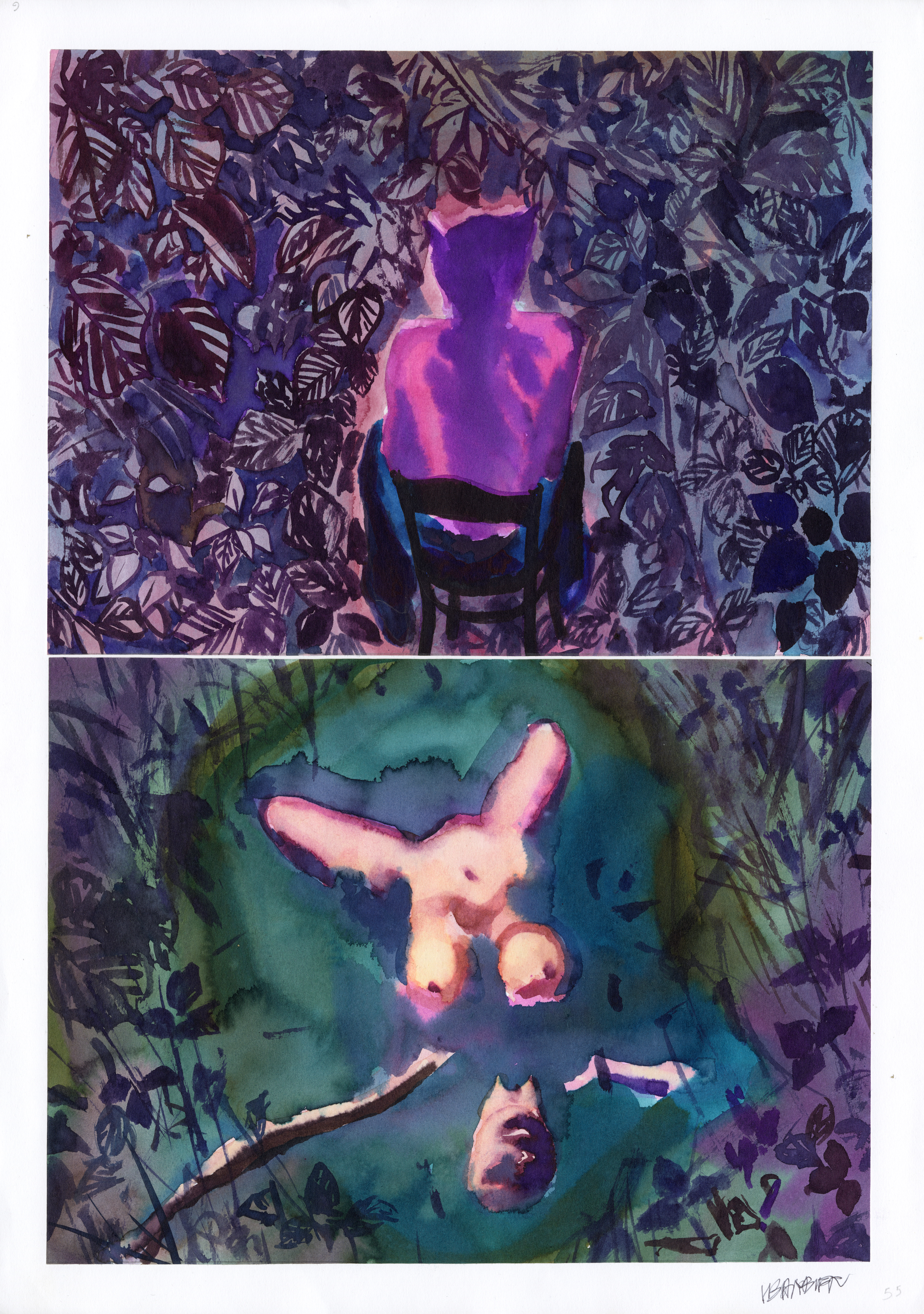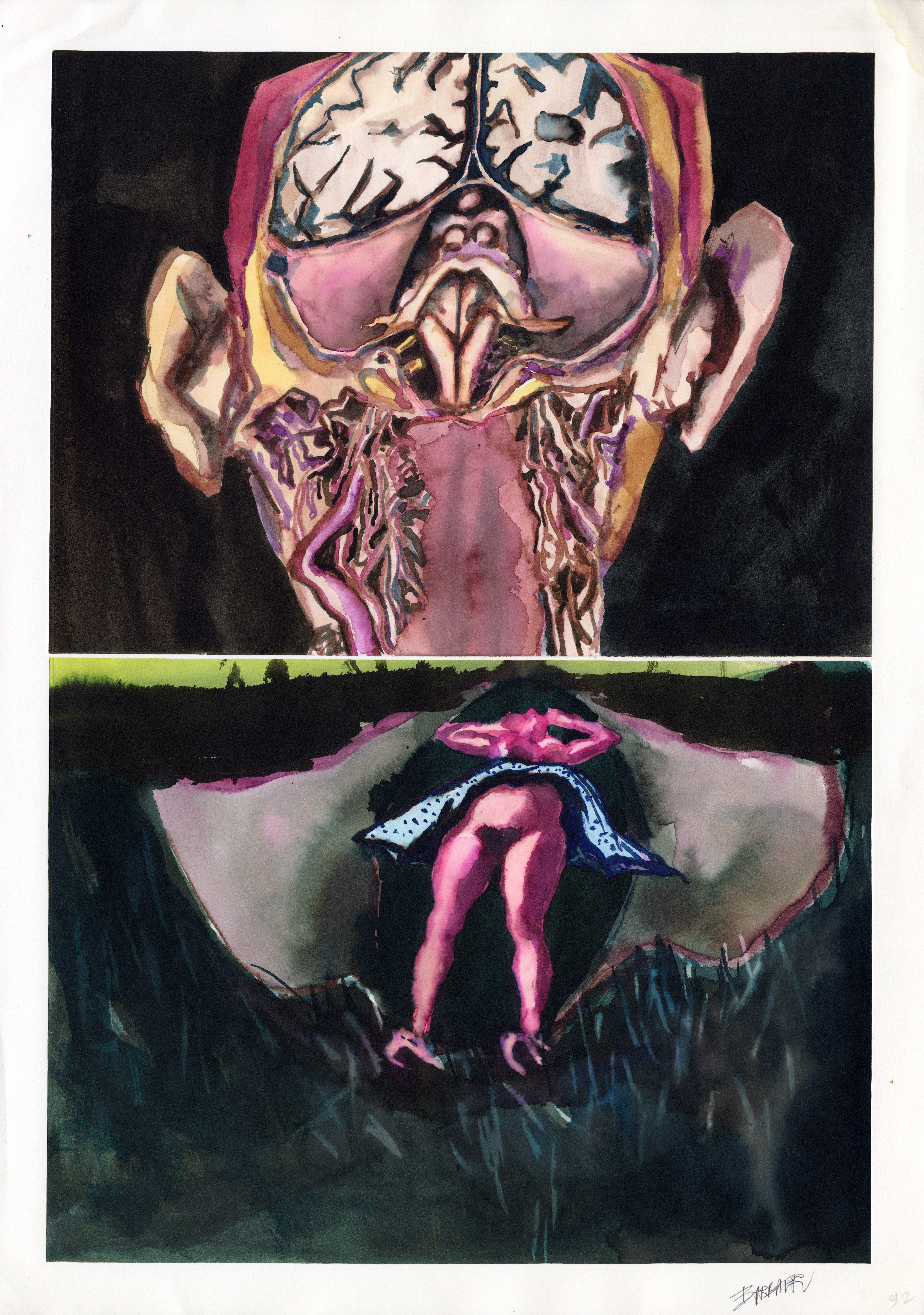ALEX BARBIER
Exposition du 21 octobre au 26 novembre 2022
Créateur au sens pur, passé du dessin à la peinture sans cesser de planter ses crocs dans son univers fantasmatique, Alex Barbier a bouleversé les codes de la BD. Pionnier de la couleur directe, cet « artiste pour artistes » a déchaîné l’enthousiasme de ses pairs. Disparu voici trois ans, il mérite aujourd’hui une vraie ouverture au public.
À partir du 21 octobre, la Galerie Martel est donc heureuse de présenter une sélection de planches et de peintures de cet artiste hors-norme – y compris des originaux de Métempsychose, son dernier ouvrage édité par Frémok. « Je me suis formaté un univers où j’aimerais à moitié vivre. Et finalement, c’est ce que j’ai fait. J’ai à moitié vécu dans cet univers… » Cet univers-là, Alex Barbier l’évoque désormais dans des vidéos : il est mort en 2019, à 68 ans. Cet univers-là s’est épanoui dans son œuvre trop compacte et trop brève. Cet univers-là a deux clés. L’alcool. Il raconte que le matin, avant l’école – il avait huit ans – on lui donnait à boire un « fortifiant » : un œuf battu, beaucoup de sucre, du mousseux. « Après, raconte-t-il, j’étais… bien. » Et la sexualité. Plutôt, le sexe entre garçons. Il l’a goûté jeune – alors l’enseignement n’était pas mixte – pour le retrouver hardcore au service militaire, arrosé de Mandrax, ce sédatif aphrodisiaque.
Évidemment, son talent magistral ne se résume pas à ça. Mais c’est ainsi que son univers imaginaire et artistique s’est formaté. À coup de flashbacks hallucinés. Thierry van Hasselt, son éditeur actuel au Frémok, a rencontré Barbier dans les années 1990. Autour de Paysage de la nuit et Comme un poulet sans tête, Angoulême consacrait une expo à l’artiste dont Delcourt avait repris la publication. Depuis dix ans, sa carrière était en panne. « C’était un personnage impressionnant », se souvient van Hasselt. « Il portait le trouble vénéneux de ses BD. Comme l’aura dégagée par un William S. Burroughs. » Pour publier Barbier, van Hasselt et ses comparses du futur Fremok ajouteront un cahier couleur à leur revue : l’artiste ne travaille jamais en noir et blanc.
Barbier est un pionnier de la BD en couleur directe. Pas moins. Il est entré en scène une vingtaine d’années plus tôt, avec la publication de Lycaons dans Charlie Mensuel, alors flambeau de la BD adulte. Du jamais vu. Un univers lourd et fantasmatique, des environnements plombés, un jeu de couleurs inouï. Là, des éphèbes à longs cheveux, déjà torse nu, achèvent de baisser leur bluejean. On les voit couchés, mêlés, figés dans l’acte. Francis Bacon a compté dans le regard d’Alex Barbier : « Pour le traitement de la chair. En fait, Bacon a moins joué sur mon art que sur mon existence. » Des décors déjetés, désaffectés, sans espace blanc entre les cases. Des textes posés en couleur, moins écrits que peints, avec parfois les flous, les tremblements, les pâtés de l’enfance. Wolinski, alors patron de Charlie Mensuel avec Gébé, lui dit un jour : « Tu ne te rends pas compte du bordel que tu as semé. » Et Barbier, à quelques années-lumière d’intervalle lui répond, « Je travaille toujours sur le même fond de sauce. »
Car de Lycaons à Métempsychose, dernier album de Barbier au Frémok, l’artiste a toujours rivé le même clou, poursuivant cette chimère rare, cristalline, douloureuse : une œuvre. Rien d’étonnant qu’il chérisse Céline, Dick et Proust. Lui aussi puise dans sa vie pour en extraire l’étoile. Il a besoin du vécu, du réel, pour construire son univers de rêve. Une lecture précoce de L’affaire Tournesol, album abandonné chez des grands-parents, détermina ce que serait son trajet : « La BD est la dernière chose qui s’attaque encore au réel. On peut jouer avec ça, et le mettre en danger avec une espèce d’abstraction. Mais je ne tomberai pas dans cet abîme. »
Sa détestation du non-figuratif est connue : « Pour ce qui est de ne rien dire et de ne rien représenter, l’art contemporain est imbattable. Inutile d’essayer de lutter avec lui. » Outre Hergé, il a puisé ses racines chez Franquin et Tillieux. Son amour des voitures vient de cette école. Épaulant ses fins éphèbes et ses loups-garous, il a sculpté les courbes de grosses américaines et de souples DS Citroën, les affublant en contre-champ de la planche de bord dérisoire d’une 403 Peugeot : « Il a pris pour modèle la voiture de mon père, sourit Aline Barbier, épouse complice de sa vie et de son œuvre. Alex adorait les voitures mais n’avait pas le permis. Je conduisais. » Toujours l’oscillation éperdue entre deux demi-univers. La même faim l’amenait à prendre des centaines de photos d’êtres – proches ou non, et dont certains ignoraient ce que leur image allait devenir – ou de décors en perdition.
Comme le casino abandonné de V., station thermale à un jet de pierre du village pyrénéen où il élut un temps domicile. Étudiant aux Beaux-Arts sur la fin des années 60, il avait lu Hara-Kiri qui publiait alors le Jodelle et le Pravda de Guy Pellaert : « Un maître. Un peu daté, mais pas vieilli. » Référence qu’il dépassa elle aussi pour devenir lui-même, comme il avait digéré sans les rejeter la ligne claire et ses codes. Il fut ensuite prof d’arts plastiques, mais ses cheveux teints en rouge et ses méthodes le firent vite chasser de l’Éducation nationale. Puis il tomba, dans une vente aux enchères, sur un lot d’encres anciennes, « très belles, d’un noir bleuté. » On connaît la suite magnifique. Le vrai fil de cette vie subversive et sérieuse, douloureuse et drôle, âpre, acharnée, jouissante ? C’est l’œuvre.
Mais si l’on veut un portrait d’Alex Barbier venu de notre monde réel, laissons parler l’un de ses petit-fils, alors enfant : « Il a les cheveux jaunes et il parle beaucoup. Il parle bien, mais je ne comprends pas tout. »
François Landon